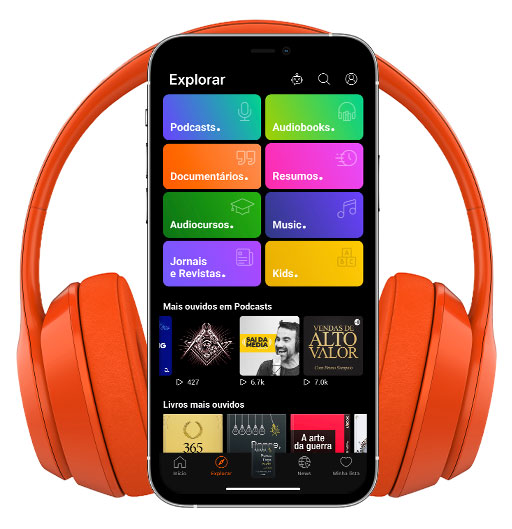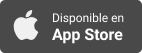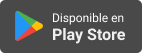Informações:
Sinopsis
Une émission de l’AIU, préparée et présentée alternativement par Frédérique Leichter-Flack et Ariel Danan le dimanche 13h30-14h.« Le bénéfice du doute » abordera chaque semaine une problématique différente, en prise avec les enjeux du moment mais à distance cependant des discours tranchés de lactualité immédiate. En compagnie dun invité – philosophe, sociologue ou historien, juriste, économiste ou médecin, du monde des idées ou de la société civile – on tentera ensemble le questionnement éthique propre à rendre complexité à la décision, prudence à laction et fondement au discours. Manière de revendiquer la pertinence du dialogue qui peut se nouer, sur le terrain des valeurs, entre les humanités juives et le temps présent en accordant, le temps dune discussion, à chaque question le bénéfice du doute.
Episodios
-
La littérature a-t-elle vocation à réparer le monde? ( Part I )
17/12/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack A quoi sert la littérature? Longtemps la question aurait paru déplacée ou incongrue, tant il allait de soi que la littérature n'avait pas à se justifier et pouvait se soustraire au régime de l'utilité sociale. Mais d'ateliers d'écriture en clubs de lecture, de bibliothérapie en médecine narrative, des réponses décomplexées revendiquent désormais de plus en plus fréquemment de voir dans l'écriture, comme dans la lecture, une machine à nous faire du bien. Sauver, soigner, guérir nos blessures, surmonter nos traumas, prendre en charge le malheur ou le deuil, sortir les subalternes et les invisibles de l'anonymat et de l'oubli, mener les procès en réparation mémorielle des grandes catastrophes historiques sur lesquelles la justice n'a pas assez de prise... en un mot, réparer le monde : la littérature contemporaine, selon Alexandre Gefen qui lui consacre un passionnant essai de synthèse, se voit désormais assigner une vocation de "tikkun olam". Quel
-
L’Ethique et la Loi. La valeur de la vie dans la hiérarchie des valeurs (Part II)
10/12/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack Peut-on questionner les textes de la tradition à la lumière de nos aspirations éthiques ? « Qui sauve une vie sauve l’humanité » : le Talmud énonce clairement la valeur de la vie, et le principe du pikuakh nefesh engage à transgresser la loi quand il s’agit de sauver une vie. La valeur de la vie est-elle donc installée au sommet de la pyramide des valeurs ? Au point de valoriser la survie à tout prix ? Mais de quelle vie parle-t-on, une vie juive ou une vie tout court? En examinant, dans La Vie hors la Loi, la littérature rabbinique autour du pikuakh nefesh, et ses applications au moment de la Shoah (notamment le remplacement du commandement du martyre par le commandement de survie), David Meyer interroge la hiérarchie des valeurs dans le judaïsme. Le questionnement sur le rapport entre l’éthique et la loi est élargi dans son autre livre, Les Versets douloureux : que faire aujourd’hui de tous ces passages des textes bibliques et rabbiniques qui
-
La survie, 614eme commandement ? Les théologies post-Shoah (Part I)
26/11/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack Comment être en paix avec Dieu après la Shoah ? Nombre de notions traditionnelles, comme l’idée de Providence, le concept de l’élection, l’explication du mal par le principe « à cause de nos fautes » ou la justification du martyre, sortent profondément altérées, voire directement contestées, par l’expérience de la Shoah. Ce n’est pas seulement un enjeu pour les théologiens, c’est aussi un problème très concret qui engage la transmission du judaïsme (comment transmettre aux enfants la confiance en un Dieu tout-puissant et bienveillant, en même temps que la mémoire de l’extermination massive de tout son peuple ?) et la survie du peuple juif pour l’avenir. A côté d’Elie Wiesel ou d’André Neher, bien connus en France, plusieurs penseurs anglophones, peu ou pas traduits en français, comme Fackenheim, Rubenstein ou Berkovitz, ont réfléchi à ces questions. Fackenheim va ainsi jusqu’à proposer d’entendre dans « la Voix prescriptive d’Auschwitz »,
-
Ecrire l’histoire des Juifs en terre d’Islam
12/11/2017Emission présentée par Ariel Danan Georges Bensoussan a choisi de s’intéresser à cette problématique en se demandant pourquoi les Juifs ont quasi-totalement quitter l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient en quelques années seulement. Si la création de l’Etat d’Israël et le conflit israélo-arabe en sont une raison, c’est loin d’être la seule. Il faut analyser ce départ sur le temps long en étudiant ce qu’était la situation socio-économique et politique des Juifs dans ces pays. La nuance est de mise : ce ne fut ni un long fleuve tranquille, ni une suite de persécutions et les situations varient d’une époque à l’autre, d’un lieu à un autre. Il n’en demeure pas moins que les Juifs, dès le 19ème siècle, sont inexorablement attirés par l’occidentalisation qui leur permet de changer de condition juridique et de mieux se protéger contre l’antijudaïsme puis l’antisémitisme. Georges Bensoussan utilise les outils d’historien pour analyser le présent comme il l’a fait dans Les Territoires perdus de la République, la leçon
-
Enseigner l’histoire de la Shoah comme bouclier contre l’antisémitisme ?
05/11/2017Emission présentée par Ariel Danan Comment écrire l’histoire le plus scientifiquement possible ? Au-delà des techniques de l’historien et de l’impartialité que ce dernier s’efforce de respecter, il faut pour Georges Bensoussan se connaître soi-même, savoir ses partis-pris pour mieux les empêcher d’influencer sa réflexion. Selon lui, l’histoire de la Shoah est mal enseignée en France aujourd’hui ; son hypermnésie ne protège pas de l’antisémitisme. De plus, il ne faut pas tendre vers une histoire exclusivement lacrymale du peuple juif dont la Shoah serait l’aboutissement. A travers ces exemples, Georges Bensoussan montre combien l’écriture de l’histoire peut être influencée par une volonté politique, que doit analyser l’historien pour mieux s’en défaire. À propos du livre : "Les juifs du monde Arabe: La question interdite" paru aux éditions Odile Jacob La paix des religions est-elle possible ? L’histoire n’en offre-t-elle pas des exemples ? La période d’Al Andalus ne fut-elle
-
Survivre à tout prix ? De l’honneur en situation extrême / invité Jean-Michel Chaumont / Part II
29/10/2017Emission présentée par Frédérique Leichter-Flack Trahir ou mourir - jusque dans les situations extrêmes, les valeurs de l’honneur tracent les limites à ne pas franchir pour ne pas « perdre son âme ». Pourtant, la survie a aussi ses droits. Peut-on explorer les affres morales des hommes placés en situation extrême ? Comment le faire sans juger ? Comment comprendre qu’on ait pu demander des comptes aux survivants du prix payé pour leur survie ? Dans son nouveau livre, Survivre à tout prix, Jean-Michel Chaumont entreprend une exploration risquée de la tension entre morales de l’honneur et éthiques de la survie, à propos de trois catégories de « survivants » sommés de rendre des comptes : les résistants communistes belges sortis vivants des salles de torture gestapistes, les rescapés des camps nazis qui ont survécu là où tous les autres ont péri, et les femmes violées ayant survécu au viol. Jean-Michel Chaumont est sociologue et historien des idées. Professeur à l’université catholique de Louvain, ancien collabo
-
Survivre à tout prix ? De l’honneur en situation extrême / invité Jean-Michel Chaumont / Part I
22/10/2017Emission présentée par Frédérique Leichter-Flack Trahir ou mourir - jusque dans les situations extrêmes, les valeurs de l’honneur tracent les limites à ne pas franchir pour ne pas « perdre son âme ». Pourtant, la survie a aussi ses droits. Peut-on explorer les affres morales des hommes placés en situation extrême ? Comment le faire sans juger ? Comment comprendre qu’on ait pu demander des comptes aux survivants du prix payé pour leur survie ? Dans son nouveau livre, Survivre à tout prix, Jean-Michel Chaumont entreprend une exploration risquée de la tension entre morales de l’honneur et éthiques de la survie, à propos de trois catégories de « survivants » sommés de rendre des comptes : les résistants communistes belges sortis vivants des salles de torture gestapistes, les rescapés des camps nazis qui ont survécu là où tous les autres ont péri, et les femmes violées ayant survécu au viol. Jean-Michel Chaumont est sociologue et historien des idées. Professeur à l’université catholique de Louvain, ancien collabo
-
La voix et l’écho
15/10/2017Emission présentée par Ariel Danan Si la Voix de Dieu s’est tue, son écho – son interprétation – n’est point tari. Il revient à chacun d’interroger encore et toujours les textes de la Tradition juive en fonction du présent. C’est la volonté qui anime tous les programmes d’enseignement supérieur de l’AIU – notamment le Beth Hamidrach et le SNEJ – donnant la possibilité à tous d’étudier tous les domaines qui ont contribué à la constitution de l’identité du peuple juif et à ses mutations successives au cours de son histoire. Armand Abécassis, professeur émérite de philosophie générale et comparée à l’université Michel de Montaigne, Bordeaux, est directeur des études juives à l’Alliance israélite universelle où il a développé le Beth Hamidrach Alliance Jules Braunschvig. Fabienne Sabban, membre du Haut Conseil de l’Alliance israélite universelle, est la créatrice du programme « A Torah et à Travers : ouvertures bibliques pour décideurs ». Jonathan Zribi est le coordinateur de la Section normale des Etudes
-
Les enjeux du Judaïsme contemporain en questions
08/10/2017Emission présentée par Ariel Danan Quels sont les enjeux du Judaïsme aujourd’hui, particulièrement en France ? L’orthodoxie moderne, présente principalement aux Etats-Unis et en Israël, représente une nouvelle voix en France et est en mesure d’apporter des réponses inédites, en respectant ses trois fondamentaux : un respect de la halakha en accord avec la vision orthodoxe, une attitude positive vis-à-vis de la culture profane et une adhésion au sionisme. Gabriel Abensour qui, par son blog, a donné une voix à l’orthodoxie moderne en France, analyse les principaux débats autour de la place de la femme dans l’espace synagogal et du drame des femmes auxquelles le mari refuse de donner le divorce religieux. Des solutions orthodoxes sont possibles, certaines déjà envisagées par les rabbins sépharades il y a plus d’un siècle. Originaire de Strasbourg, Gabriel Abensour vit en Israël. Après 5 années dans une école talmudique, il poursuit des études à l’Université hébraïque de Jérusalem où il début un maste
-
Face au Mal et à l’injustice des sorts : relire le livre de Job / Part II / Invitée : Isabelle Cohen
01/10/2017Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens innocents ? Le livre de Job est sans doute la plus ancienne formulation, littéraire et spirituelle, du scandale du Mal. Inscrit dans le canon biblique, c’est pourtant un texte qui va très loin – parfois à la limite du blasphème et de la révolte - dans le questionnement sur Dieu et la théodicée. Sa remise en cause de la doctrine de la rétribution y est explicite et brutale : non, tous les malheureux ne sont pas des coupables qui s’ignorent, punis pour leurs fautes supposées… et oui, il n’est pas rare que les justes souffrent et que les méchants prospèrent… comment alors accepter un Dieu qui laisse faire ? Lire le livre de Job est une expérience morale, spirituelle, et intellectuelle cruciale, et c’est dans cette aventure que nous entraîne la nouvelle traduction commentée d’Isabelle Cohen, en restituant au texte hébraïque toute sa puissance poétique, et au questionnement de Job toute son exigence. Chargée de mission à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Is
-
Face au Mal et à l’injustice des sorts : relire le livre de Job / Part I / Invitée : Isabelle Cohen
24/09/2017Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens innocents ? Le livre de Job est sans doute la plus ancienne formulation, littéraire et spirituelle, du scandale du Mal. Inscrit dans le canon biblique, c’est pourtant un texte qui va très loin – parfois à la limite du blasphème et de la révolte - dans le questionnement sur Dieu et la théodicée. Sa remise en cause de la doctrine de la rétribution y est explicite et brutale : non, tous les malheureux ne sont pas des coupables qui s’ignorent, punis pour leurs fautes supposées… et oui, il n’est pas rare que les justes souffrent et que les méchants prospèrent… comment alors accepter un Dieu qui laisse faire ? Lire le livre de Job est une expérience morale, spirituelle, et intellectuelle cruciale, et c’est dans cette aventure que nous entraîne la nouvelle traduction commentée d’Isabelle Cohen, en restituant au texte hébraïque toute sa puissance poétique, et au questionnement de Job toute son exigence. Chargée de mission à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Is
-
« l’égalité des chances: une ambition française ? » / invité Mounir Mahjoubi / interview Ilana Cicurel
17/09/2017Intervention de Mounir Mahjoubi au Collège franco-israélien mikvé israël Mounir Mahjoubi est nommé Le 17 mai 2017 secrétaire d’État chargé du numérique dans le gouvernement Édouard Philippe. Lors des élections législatives 2017, il est élu, le 18 juin, député de la seizième circonscription de Paris pour La République en Marche.
-
La ruse et la force. Ethique de la guerre / invité Jean-Vincent Holeindre
02/07/2017Si dans toute guerre l’objectif des belligérants est de remporter la victoire, il y a manière et manière de s’y employer : l’efficacité doit composer avec le souci de légitimité. Depuis l’Antiquité grecque et biblique jusqu’aux guerres asymétriques contemporaines et à la lutte contre les mouvements terroristes transnationaux, l’histoire de la stratégie militaire, racontée dans le livre de Jean-Vincent Holeindre, donne à voir la tension constamment renégociée entre tenants de la force et tenants de la ruse. Jean-Vincent Holeindre est professeur de sciences politiques à l’université de Poitiers et directeur scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM). Son livre La Ruse et la force. Une autre histoire de la stratégie (ed. Perrin 2017) a reçu le Prix Emile Perreau-Saussine 2017 pour la philosophie politique et les sciences humaines. À propos du livre : La ruse et la force aux éditions Perrin Au VIIIe siècle avant J.-C., Homère expose de manière frappante la dualité qui fond
-
Ecrire sur la Shoah dans l’ex-Union Soviétique, hier et aujourd’hui. Part II
25/06/2017Babi Yar, le ravin où la population juive de Kiev a péri massacrée au moment de l'invasion de l'URSS par les nazis, est pour nous un symbole de la Shoah par balles. Mais le symbole ne vaut pas uniformément partout. Démêler l’écheveau de la mémoire du Mal en ex-URSS est une tâche complexe : sur les « terres de sang » (Snyder) où la moitié du génocide juif a eu lieu, la mémoire de la Shoah, longtemps empêchée, s’est mêlée et superposée à d’autres strates mémorielles, au souvenir également empêché d’autres traumatismes collectifs, créant un effet de brouillage. La littérature peut-elle nous aider à y voir plus clair et à articuler la mémoire du génocide juif aux mémoires conflictuelles de l’ex-Union Soviétique ? Annie Epelboin, universitaire, est spécialiste de littérature soviétique. Elle a notamment publié (avec Assia Kovriguina) La Littérature des Ravins. Ecrire sur la Shoah en URSS (éd. Laffont, 2013), et édité en traduction française la version non-expurgée du roman-document Babi Yar d’Anatoli Kouznetsov (é
-
Ecrire sur la Shoah dans l’ex-Union Soviétique, hier et aujourd’hui. Part I
18/06/2017Babi Yar, le ravin où la population juive de Kiev a péri massacrée au moment de l'invasion de l'URSS par les nazis, est pour nous un symbole de la Shoah par balles. Mais le symbole ne vaut pas uniformément partout. Démêler l’écheveau de la mémoire du Mal en ex-URSS est une tâche complexe : sur les « terres de sang » (Snyder) où la moitié du génocide juif a eu lieu, la mémoire de la Shoah, longtemps empêchée, s’est mêlée et superposée à d’autres strates mémorielles, au souvenir également empêché d’autres traumatismes collectifs, créant un effet de brouillage. La littérature peut-elle nous aider à y voir plus clair et à articuler la mémoire du génocide juif aux mémoires conflictuelles de l’ex-Union Soviétique ? Annie Epelboin, universitaire, est spécialiste de littérature soviétique. Elle a notamment publié (avec Assia Kovriguina) La Littérature des Ravins. Ecrire sur la Shoah en URSS (éd. Laffont, 2013), et édité en traduction française la version non-expurgée du roman-document Babi Yar d’Anatoli Kouznetsov (é
-
Le Golem du futur : «Faut-il craindre l’intelligence artificielle », invité Jean-Gabriel Ganascia
04/06/2017À propos du livre : «Le mythe de la Singularité - Faut-il craindre l'intelligence artificielle ?» aux éditions Science Ouverte Seuil L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle des humains ? Ce moment critique, baptisé " Singularité technologique ", fait partie des nouveaux buzzwords de la futurologie contemporaine et son imminence est proclamée à grand renfort d'annonces mirobolantes par des technogourous comme Ray Kurzweil (chef de projet chez Google !) ou Nick Bostrom (de la vénérable université d'Oxford). Certains scientifiques et entrepreneurs, non des moindres, tels Stephen Hawking ou Bill Gates, partagent ces perspectives et s'en inquiètent. Menace sur l'humanité et/ou promesse d'une transhumanité, ce nouveau millénarisme est appelé à se développer. Nos machines vont-elles devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous ? Notre avenir est-il celui d'une cybersociété où l'humanité serait marginalisée ? Ou accéderons-nous à une forme d'immortalité en téléchargeant nos esprits sur
-
« Enseigner la France (aux demandeurs d’asile) », invitée, Ayyam Sureau / Part II
28/05/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack, les Dimanches de 13h30 à 14h00 Faut-il – et comment ? - « enseigner la France » aux réfugiés nouveaux-venus ? Au-delà de la langue, que faut-il enseigner de la France, de son histoire, de ses valeurs, de sa culture, pour permettre, après l’accueil d’urgence, une intégration réussie dans la société française ? Du débat sur le roman national et l’enseignement de l’histoire à l’école, à la polémique sur l’essentialisation de la « culture française » face aux « cultures en France », en passant bien sûr par les discours sur l’insolubilité supposée de certaines cultures d’origine dans la citoyenneté française, la question de l’intégration culturelle des demandeurs d’asile interfère avec les doutes français récurrents sur la juste manière de transmettre ce qui nous tient ensemble et ce qui nous tient à coeur. L’expérience menée depuis dix ans avec succès par l’association Pierre Claver – une école parisienne pour jeunes adultes demandeurs d’asile – a
-
« Enseigner la France (aux demandeurs d’asile) », invitée, Ayyam Sureau / Part I
21/05/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack, les Dimanches de 13h30 à 14h00 Faut-il – et comment ? - « enseigner la France » aux réfugiés nouveaux-venus ? Au-delà de la langue, que faut-il enseigner de la France, de son histoire, de ses valeurs, de sa culture, pour permettre, après l’accueil d’urgence, une intégration réussie dans la société française ? Du débat sur le roman national et l’enseignement de l’histoire à l’école, à la polémique sur l’essentialisation de la « culture française » face aux « cultures en France », en passant bien sûr par les discours sur l’insolubilité supposée de certaines cultures d’origine dans la citoyenneté française, la question de l’intégration culturelle des demandeurs d’asile interfère avec les doutes français récurrents sur la juste manière de transmettre ce qui nous tient ensemble et ce qui nous tient à coeur. L’expérience menée depuis dix ans avec succès par l’association Pierre Claver – une école parisienne pour jeunes adultes demandeurs d’asile – a
-
Après Babel. Eloge de la traduction-Part II
14/05/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack, les Dimanches de 13h30 à 14h00 Le mythe de Babel nous rappelle que langage, identité, et politique ont partie liée. Relire Babel, non comme châtiment mais comme chance et comme vocation, c’est réfléchir sur les opportunités et les défis que nous ouvre notre conscience de la diversité des langues. A commencer par le travail, jamais définitif, de traduction des « intraduisibles » en philosophie, et à la nécessité de faire sans cesse circuler la pensée dans l’entre-deux d’une langue à l’autre. « La langue de l’Europe, c’est la traduction », écrivait Umberto Eco. Sans céder à la facilité du « globish » (global english), ni attiser le nationalisme ontologique d’un supposé génie des langues, le passionnant Eloge de la Traduction que signe Barbara Cassin nous invite à « compliquer l’universel ». Barbara Cassin, philosophe et philologue, helléniste et spécialiste de sophistique grecque, est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages de philosophie, dont l
-
Après Babel. Eloge de la traduction-Part I
07/05/2017Une émission préparée et présentée par Frédérique Leichter-Flack, les Dimanches de 13h30 à 14h00 Le mythe de Babel nous rappelle que langage, identité, et politique ont partie liée. Relire Babel, non comme châtiment mais comme chance et comme vocation, c’est réfléchir sur les opportunités et les défis que nous ouvre notre conscience de la diversité des langues. A commencer par le travail, jamais définitif, de traduction des « intraduisibles » en philosophie, et à la nécessité de faire sans cesse circuler la pensée dans l’entre-deux d’une langue à l’autre. « La langue de l’Europe, c’est la traduction », écrivait Umberto Eco. Sans céder à la facilité du « globish » (global english), ni attiser le nationalisme ontologique d’un supposé génie des langues, le passionnant Eloge de la Traduction que signe Barbara Cassin nous invite à « compliquer l’universel ». Barbara Cassin, philosophe et philologue, helléniste et spécialiste de sophistique grecque, est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages de philosophie, dont l